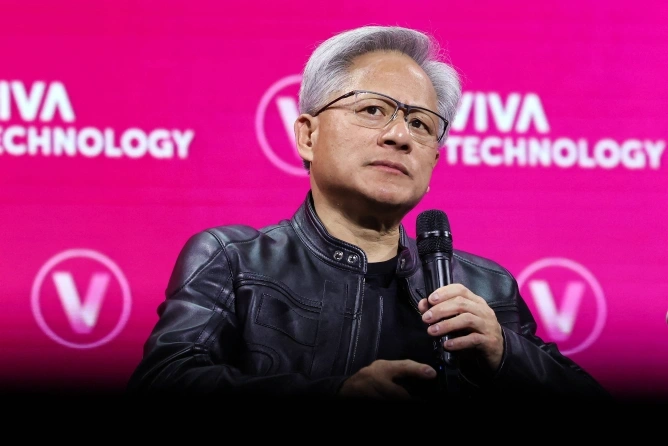Un patient en coma depuis 2003, réveillé aujourd'hui, serait dérouté par de nombreuses choses, y compris le rôle de l'Union européenne en tant qu'acteur de sécurité. L'un de ses derniers souvenirs serait la première Stratégie de sécurité de l'Union européenne, qui débutait par la phrase : « L'Europe n'a jamais été aussi prospère, aussi sûre et aussi libre ». Comment en est-on arrivé à ce que, en 2025, l'Union européenne lance l'Action pour la Sécurité de l'Europe (SAFE), un instrument financier sous forme de prêts, d'une valeur de 150 milliards d'euros, dédié aux investissements urgents dans le domaine de la défense ?
Rapporté à l'échelle de l'histoire, le chemin a été remarquablement court. La nature avec laquelle nous nous rapportons aujourd'hui à l'Union européenne en tant qu'acteur de sécurité montre à quel point la transformation a été profonde.
Le premier choc, la crise de la zone euro (2010-2013), a annoncé une décennie de crises pour l'Union : de la crise de l'euro à celle de la migration (2015-2016) et jusqu'à la pandémie de COVID-19. Malgré leur gravité et leur prolongement, aucune de ces crises n'est directement corrélée au nouveau rôle de l'Union européenne en tant qu'acteur de sécurité.
Dans la seconde moitié des années 2010, l'architecture de sécurité européenne était prise entre deux mondes. D'une part, les accords de Minsk I et II ont représenté un dernier sursaut de la logique des « grandes puissances », dans laquelle la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont soutenu politiquement les accords trilatéraux Ukraine-Russie-OSCE. Dans les années suivantes, l'Union européenne a assumé, par des documents programmatiques, un rôle de plus en plus clair d'acteur de sécurité, lançant des initiatives qui ont posé les bases de l'écosystème d'aujourd'hui.
Le moment de départ de cette transformation a été l'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie, en 2014, et la guerre non déclarée menée par les soi-disant « hommes en vert » dans l'est de l'Ukraine. En 2016, l'UE a adopté la Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité (EUGS). En 2017, un ensemble d'initiatives complémentaires a été lancé : la Coopération structurée permanente (CSP/PESCO), le Fonds européen de défense (EDF), la Capacité militaire de planification et de conduite (MPCC) et la Revue annuelle coordonnée dans le domaine de la défense (CARD).
En 2019, Ursula von der Leyen a pris la tête de la première « Commission géopolitique », dans le but de transformer le capital économique, diplomatique, culturel et militaire de l'Union en une posture géopolitique globale, aux côtés des États-Unis et de la Chine. La même année, le Fonds européen de défense (EDF) est devenu opérationnel, suivi d'une nouvelle déclaration conjointe OTAN-UE, qui a réaffirmé la coopération entre les deux organisations et la promotion du concept d'« autonomie stratégique », initialement lancé par le président français Emmanuel Macron. En mars 2021, la Facilité européenne pour la paix (EPF) a été créée, avec un budget initial de 5,69 milliards d'euros, utilisé notamment pour soutenir l'Ukraine après l'invasion de 2022.
2022 a été un tournant. En mars 2022, la Boussole stratégique a été lancée, un document en cours de rédaction au moment de l'invasion et ajusté pour refléter la réalité de la guerre à grande échelle sur le continent. Le document prévoit la création d'une Capacité de déploiement rapide (RDC) dans le cadre de la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC), avec des décisions d'utilisation adoptées à l'unanimité au Conseil de l'UE, sur proposition du Haut Représentant. En 2023, une nouvelle déclaration conjointe UE-NATO a suivi, élargissant la coopération aux menaces hybrides, à l'infrastructure énergétique et à la sécurité cybernétique. La même année, le Règlement sur le renforcement de l'industrie européenne de défense par des achats publics communs (EDIRPA) a été adopté, conçu comme un mécanisme temporaire pour des achats communs, sur fond d'épuisement des stocks après les dons à l'Ukraine.
En mars 2024, la Commission européenne a adopté le programme de travail EDIRPA et a lancé des appels à propositions dans trois directions : munitions (de l'armement léger à l'artillerie, aux mortiers et aux missiles), défense aérienne et antimissile, ainsi que plateformes et remplacement des anciens systèmes, marquant le passage du cadre législatif à la phase opérationnelle. La même année, la première Stratégie industrielle dans le domaine de la défense a été adoptée, établissant un objectif de 40 % pour des achats coordonnés au niveau européen et la promotion de normes communes.
En 2025, SAFE a été adopté, et la Roumanie figure comme le deuxième bénéficiaire du programme, avec des allocations de 16,6 milliards d'euros. Une confusion persiste dans l'espace public, y compris dans les communications du Ministère des Investissements et des Projets Européens, selon lesquelles la Roumanie « reçoit » cet argent. En réalité, il s'agit de prêts, à des taux compétitifs et à des maturités longues, contractés sur la base de la note maximale de l'UE, qui permettent des coûts plus avantageux que ceux obtenus, en général, sur les marchés nationaux.
Le parcours de l'Union européenne au cours de la dernière décennie est marqué par quatre tendances majeures : 1) le passage d'initiatives politiques à des mécanismes opérationnels et des instruments communs d'action et de financement ; 2) la mise en commun des ressources, de la finance et de la production aux achats et aux stocks ; 3) l'augmentation exponentielle des sommes allouées, passant de 5,69 milliards d'euros en 2021 (EPF) à 150 milliards d'euros en 2025 (SAFE) ; 4) l'européanisation des capacités de production, avec des seuils minimaux d'origine européenne pour les composants dans les programmes de financement.
Pourquoi cette métamorphose ? L'élément le plus important est le caractère organique du processus. Il existe un large consensus parmi les États européens selon lequel les défis de sécurité dépassent les capacités nationales. L'UE est un acteur géopolitique de « première ligue » aux côtés des États-Unis et de la Chine, tandis que, prises individuellement, même les États européens les plus riches se rapprochent plutôt du niveau des États américains les plus riches. C'est un processus prolongé de prise de conscience de la diminution relative du pouvoir européen sur la scène mondiale, commencé au moins avec la crise du canal de Suez (1956) et culminant, au niveau européen, avec les accords de Minsk – une dernière manifestation d'une logique de « grande puissance » européenne.
Une question légitime est : que signifie ce statut pour l'OTAN ? La réponse : beaucoup, mais pas dans une logique de somme nulle. L'OTAN est une alliance sans un budget commun substantiel (environ 3 milliards d'euros par an), tandis que les dépenses militaires cumulées des 32 États membres atteignent environ 1,35 trillion d'euros, dont environ 70 % reviennent aux États-Unis. L'OTAN est, en essence, un agrégateur de la volonté politique et des capacités nationales, qui facilite l'interopérabilité par des normes et des plans opérationnels communs. L'Union européenne, avec un budget annuel d'environ 190 milliards d'euros (auxquels s'ajoutent des instruments de prêt et des contributions supplémentaires), est un acteur politique et économique qui peut renforcer les capacités des États par le financement et la coordination. De là résulte une synergie naturelle entre les deux organisations.
Le vote pour le Brexit, le premier mandat de Donald Trump (y compris le sommet de l'OTAN à Bruxelles en 2018), l'ascension de la Chine, le révisionnisme de la Russie, la diplomatie de l'Inde, la compétition pour l'influence en Afrique, les crises internes de l'UE et la concentration prolongée sur le « pouvoir normatif » – tout cela a contribué à accélérer la transformation, forcée par les circonstances, de l'Union européenne en un acteur de sécurité.
Dans les années à venir, ces tendances se renforceront probablement. Tous les documents programmatiques ne seront pas mis en œuvre intégralement, mais l'ensemble du projet européen a toujours fonctionné comme un laboratoire d'idées et de compromis, et les initiatives en matière de défense ne font pas exception. Très probablement, la direction est établie, et les motivations – internes et externes – qui ont généré le changement continueront à façonner l'Union européenne dans les décennies à venir. La partie positive est que ce changement, bien que profond, a déjà été assimilé relativement rapidement tant par les institutions européennes que par les citoyens.
https://2eu.brussels/articol/defencecyber/metamorfoza-inevitabila-a-uniunii-europene